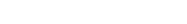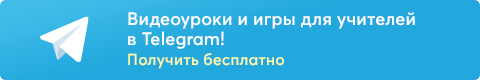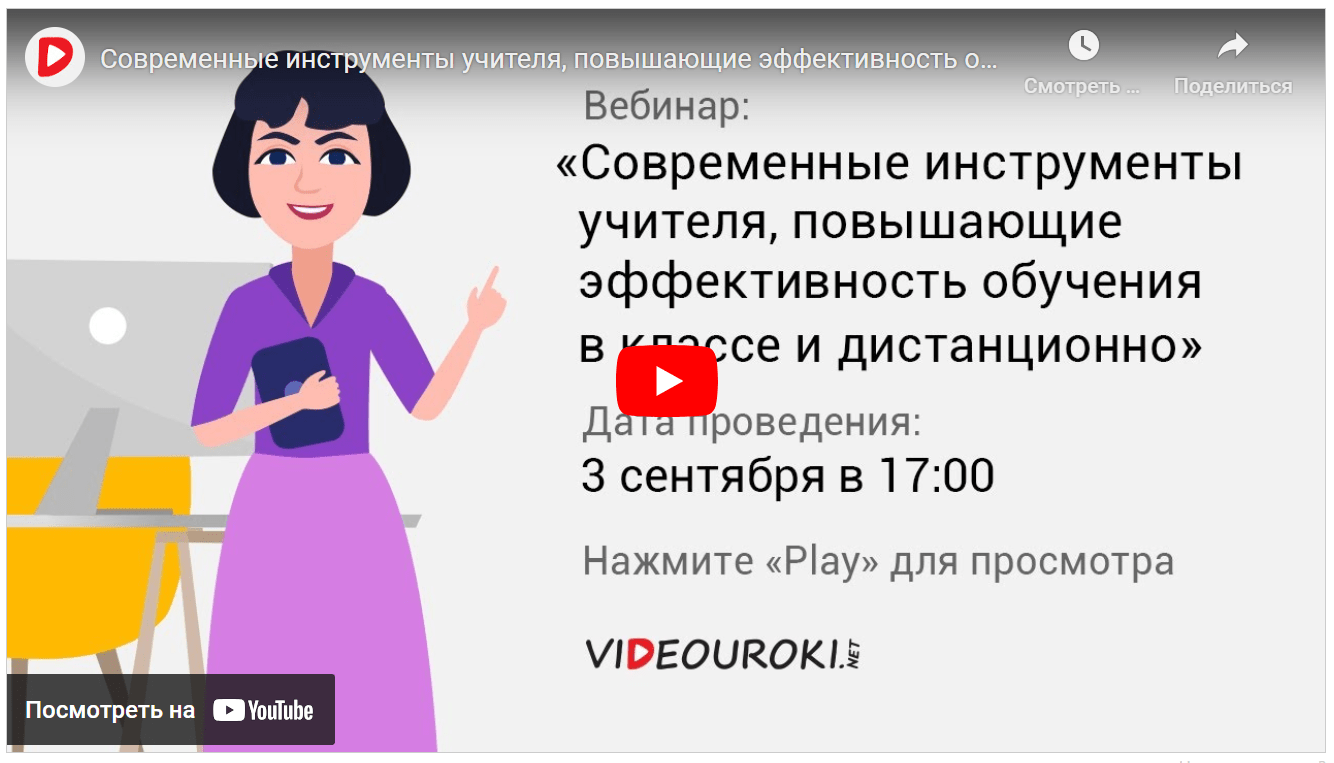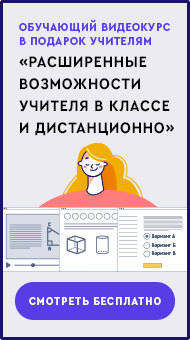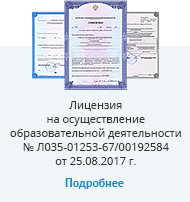Elsa Triolet. Les roses à crédit
I. Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Qui est Elsa Triolet?
2. De quelle famille provient-elle ? Quels sont ses souvenirs d’enfance ?
3. D’où est sa passion pour la poésie ?
4. Qui a prédit son futur d’écrivain ?
5. Quels événements se sont passés dans la vie d’Elsa avant sa rencontre avec Louis Aragon ?
6. De quoi s’occupait-elle entre 1928-1938 ?
7. Quels événements inspiraient son oeuvre ?
Elsa Triolet
Elsa Triolet, née Ella Kagan le 12 septembre 1896 à Moscou et morte le 16 juin 1970 à Saint-Arnoult-en-Yvelines, est une femme de lettres et résistante française née de parents juifs de Russie. Elle est également connue sous le pseudonyme de Laurent Daniel.
De son vrai nom Ella Kagan (puis Triolet de son premier mari, nom qu'elle gardera toute sa vie), elle est fille de Elena Youlevna Berman (pianiste de grand talent, sans être musicienne professionnelle) et de l'avocat juif Youri Alexandrovitch Kagan qui s'était spécialisé dans des contrats d'artistes et d'écrivains. Elle a pour sœur aînée Lili, dont elle est très jalouse, mais qu'elle admire en même temps. À partir de ses souvenirs d'enfance, elle écrit son premier roman en russe : Fraise des bois (un surnom qu'on lui donnait quand elle était enfant, livre publié en 1926), largement empreint du sentiment d'avoir été mal-aimée par ses parents. Lili rejoindra en 1905 la Révolution russe et c'est notamment par elle qu'Elsa et Louis Aragon auront des contacts communistes en URSS. Elsa apprend le français très tôt — elle commence son journal en français en 1909. En 1915, elle rencontre le poète futuriste Vladimir Maïakovski qui deviendra ensuite le compagnon de sa sœur Lili. Elsa se découvre une passion pour la poésie qui lui fera fréquenter assidûment les cafés le soir, après ses cours à l'école d'architecture, dans un cercle littéraire autour de la figure charismatique de Maïakovski. Elle y rencontre notamment Victor Chklovski, linguiste et écrivain qui tombe amoureux d'elle, sans réciprocité, mais avec lequel elle nourrit un échange épistolaire que Chklovski publiera en 1923 sous le titre de "Zoo, lettres qui ne parlent pas d'amour ou la Troisième Héloïse". Ce recueil de lettres sera lu par Maxime Gorki, qui, ayant particulièrement goûté aux lettres d'Elsa demandera à la voir et durant leur entrevue, Gorki encourage la jeune femme à se consacrer à l'écriture.
En 1918, Elsa quitte la Russie et en 1919, elle épouse à Paris André Triolet, un officier français avec qui elle part à Tahiti pendant un an, séjour qui lui inspirera son deuxième roman en russe : À Tahiti (publié en 1925). Elle qui brûlait de quitter la Russie de la Révolution dont elle embrassait certes les idées, mais détestait les conséquences sur les conditions de vie : guerre civile, misère, famine, etc., se morfond dans l'indolence d'une île où elle cultive la nostalgie de son cher cercle littéraire de Moscou. Elle quitte son mari en 1921. C'est dans cette période qu'elle connaîtra un temps d'errance en allant à Londres, à Berlin, avec séjours ponctuels à Moscou, puis Paris où elle écrit son troisième roman en russe Camouflage (1928), sur la thématique de deux femmes en errance. Elsa exprime souvent dans ses romans une impression de solitude, bien qu'elle ait été très aimée et toujours très entourée. « Je vous présente donc cet […] inspecteur des ruines, comme quelqu'un qui a été un autre moi-même. Vous lirez, si vous le voulez bien, l'histoire de sa solitude. La solitude est un fléau qui ronge les hommes, un à un »1.
Installée à Montparnasse en 1924, elle fréquente des écrivains surréalistes et des artistes comme Fernand Léger et Marcel Duchamp.
Elle rencontre Louis Aragon en 1928 à Paris, au café La Coupole, fréquenté par beaucoup d'artistes. Il devient l'homme de sa vie, celui par qui elle peut enfin s'enraciner dans la société française. Elle devient sa muse. En 1929/1930, Elsa crée des colliers pour la haute couture pour subvenir à ses besoins et écrit des reportages pour des journaux russes ; elle traduit également des auteurs russes et français. Elle commence à écrire un premier roman en français, Bonsoir Thérèse, en 1938.
Elle se marie avec Aragon le 28 février 1939. Elle entre avec lui dans la Résistance, dans la zone Sud (à Lyon et dans la Drôme notamment) et contribue à faire paraître et à diffuser les journaux La Drôme en armes et Les Étoiles. Elle continue à écrire : le roman Le Cheval blanc et des nouvelles publiées aux Éditions de Minuit. Réunies sous le titre Le premier accroc coûte 200 francs (phrase qui annonçait le débarquement en Provence), ces nouvelles obtiennent le prix Goncourt 1945 au titre de l'année 1944. Elsa Triolet est ainsi la première femme à obtenir ce prix littéraire. Elle assiste en 1946 au procès de Nuremberg sur lequel elle écrit un reportage dans Les Lettres françaises.
La période de la guerre lui inspire le roman L’Inspecteur des ruines, puis la menace atomique, au temps de la guerre froide, Le Cheval roux. Appartenant au comité directeur du Comité national des écrivains (CNE), elle s’attache à promouvoir la lecture et la vente de livres dans les années cinquante et participe activement à un mouvement initié par le Parti communiste français en 1950-52 : "Les Batailles du Livre". Elle voyage beaucoup dans les pays socialistes avec Aragon, mais, si elle a conscience de l’antisémitisme qui atteint sa sœur et des crimes qui sont commis en Union soviétique (le compagnon de Lili Brik, le général Vitaliy Primakov, est exécuté par le régime stalinien), elle ne fait aucune déclaration publique sur ces événements[réf. nécessaire]. Elle exprime sa critique du stalinisme en 1957 dans Le Monument. Elle démissionne la même année du comité directeur du CNE, puis écrit les trois romans du cycle L’Âge de Nylon. Elle intervient activement en 1963 pour faire traduire et paraître en France le roman d’Alexandre Soljénitsyne Une journée d'Ivan Denissovitch. La façon dont la biographie de Vladimir Maïakovski était falsifiée en Union soviétique est une des raisons qui l’entraîne à écrire les romans Le Grand Jamais (1965) et Écoutez-voir(1968).
En 1965, elle préface le premier livre de Dominique Oriata Tron , Stéréophonies, publié par Pierre Seghers . En 1966, Agnès Varda réalise un court-métragedocumentaire, Elsa la rose, sur son histoire d'amour avec Aragon.
Après avoir publié La Mise en mots (collection Les Sentiers de la Création, éditions Skira, 1969) et Le rossignol se tait à l'aube (1970), Elsa Triolet meurt d'un malaise cardiaque le 16 juin 1970 dans la propriété qu'elle possède avec Aragon.
II. Lisez le résumé et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de ce roman ?
2. Quel est le sujet du roman ?
3. Quels sont les problèmes essentiels qui y sont soulevés ?
4. Quels personnages du roman y sont mentionnés?
« Les roses à crédit »
Résumé
Martine est issue d’une famille des plus modestes et son désir est de se soustraire à sa condition. Quand son amie d’école, dont la mère, Mme Donzert, est coiffeuse, parvient à ce qu’elle vienne vivre chez elle, c’est la libération : elle va enfin quitter ses nombreux frères et sœurs, sa mère aux mœurs volages et la saleté environnante de la misérable cabane qui leur fait office de foyer. Martine deviendra donc apprentie au salon de coiffure, dans un milieu où tout l’attire. Lorsque Mme Donzert part s’installer à Paris, c’est tout naturellement que Martine la suit. Toujours désireuse de côtoyer la beauté et le luxe, elle intègre un institut de soins esthétiques où elle va fréquenter le beau monde. Le hasard faisant souvent bien les choses, elle retrouve fortuitement le garçon qui, depuis des années, fait battre son cœur et qui vit lui aussi dans la capitale. Ils se marient et s’installent dans leur appartement tout neuf, cadeau de mariage de M’man Donzert. La vie aurait pu suivre paisiblement son cours si Martine ne s’était pas laisser tenter par tous les colporteurs venus la démarcher. Désireuse de meubler son intérieur aux dernières tendances, ne se satisfaisant jamais longtemps d’une nouvelle acquisition, elle contracte crédit sur crédit et s’enferme peu à peu dans une situation bien critique mais surtout irréversible.
Cet ouvrage est une plongée dans la société de consommation des années 50-60. On y comprend bien la perversité des achats à crédit et on sent très vite que Martine est aspirée par ses compulsions consommatoires. Elle développe une telle addiction qu’une marche arrière semble difficilement envisageable. L’argent qui lui brûle les doigts ne va pas seulement la plonger dans des difficultés financières incommensurables puisque, comme sous l’effet d’un raz de marée, c’est aussi l’équilibre de sa vie sociale et professionnelle qui va être balayée. Au fur et à mesure de la progression du roman, Martine devient méconnaissable. Grandeurs et décadence, tel pourrait être le sous-titre de ce roman, tant elle détruit aussi sûrement qu’elle l’avait bâti, le frêle édifice qu’est sa vie.
III. Lisez le fragment du roman et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de cet extrait ?
2. Quels sont les problèmes qui y sont soulevés ?
3. Qui et comment était le père de la famille ?
4. Qui et comment était la mère?
5. Qu’est-ce qui a provoqué la divorce ?
6. Quelle était la première aventure de Martine ?
7. Pourquoi se promenait-elle souvent dans les bois?
8. Comment était-elle traitée dans la famille ?
9. Y avait-il les causes de tel traitement ?
10. Comment étaient ses succès à l’école?
11. Quel « drame» l’a liée d’amitié avec sa voisine de table ?
12. Quelles découvertes a faites Martine dans la maison de Mme Donzert ?
Quels sentiments éprouvait-elle ?
13. Comments étaient les rapports entre elle et Mme Donzert ?
14. De quoi parlaient-elles quand Martine était venue coucher chez Mme Donzert ?
15. Quels adjectifs décrivent la salle de bains et la baignoire ?
16. Que faisaient les fillettes après le bains ? De qui parlaient-elles ?
17. Qu’est-ce que Martine a décidé de faire après la fin des études ?
18. Comment s’est passée la conversation entre Mme Donzert et Marie ?
19 Comment Mme Donzert a-t-elle trouvé les enfants de Marie et la situation de leur existence?
20. Quelle était l’histoire de la vie de Mme Donzert ?
21. Comment Martine passait-elle d’un univers à l’autre ?
22. Comment était la vie de Cécile ?
23. Comment Martine trouvait la possibilité de voir Daniel ?
24. Que faisaient les fillettes en été ?
25. Quels événements se sont passés au cours et après le bal ?
26. Donnez les caractéristiques des personnages de ces chapitres.
27. Quels détails ou faits ont une grande valeur dans la narration ?
II. MARTINE-PERDUE-DANS-LES-BOIS
Le père… On l’appelait le père, bien que Marie Vénin l’eût épousé quand elle avait déjà ses deux aînées, de pères différents et tous deux inconnus.
Le mariage était le résultat de tractations entre le curé du village et le maire. On disait que le maire était le père de l’aînée des gosses ; il était coureur, or, il y a quinze ans, il n’y a pas à dire, Marie était une fort belle fille, qui faisait courir les hommes.
Le maire obtint du Conseil municipal qu’on accordât à Marie un terrain au bout du village. Il était entendu qu’elle prendrait pour époux Pierre Peigner, le bûcheron.
Pierre Peigner était travailleur, bien qu’un peu porté sur le boisson[17]. Il accepta la femme avec les deux gosses. Il reconnut les deux aînées, tant il était épris de Marie, heureux d’avance de tout ce que la vie allait bientôt lui apporter d’inattendu, et le bien-être, et une femme bien à lui. Une femme qui ressemblait à une grande fleur de soleil, avec ses cheveux dorés autour d’un visage hâlé et rond. Elle était coquette, et si elle se lavait rarement, elle mettait une fleur dans ses cheveux jamais peignés, un collier autour du cou. Que pouvait-il rêver de mieux, Pierre Peigner, enfant de l’Assistance ?[18]
Pour commencer, il bâtit une cabane en vieilles planches, comme le font les bûcherons près d’une coupe de bois, le temps de la coupe[19]. Il se mit à défricher le terrain, à bêcher, à semer, à planter, et lorsque le maire, qui venait de temps en temps faire une petite visite aux jeunes mariés, lui a reproché que la cabane ne fût pas bien réjouissante à voir, Pierre Peigner lui dit avec indignation qu’il ne pouvait s’occuper de tout à la fois, que ce n’était là qu’un début, qu’il fallait lui laisser le temps de souffler, que tout allait être refait convenablement avec de jolies couleurs, que Marie planterait des fleurs, et que même, s’il voulait savoir, il y aurait un jet d’eau et une allée avec du gravier.
Il y avait de cela des années. La première fois que Pierre Peigner avait surpris Marie avec un homme, tout changea. Pierre comprit qu’il n’y avait rien à faire : il pouvait crier, sortir son couteau, lever et abattre les poings, rien n’aurait pu contrecarrer la passion que Marie avait pour les hommes.
Pierre allait coucher dans le bois, il buvait. Un beau jour il revint pour annoncer qu’il voulait divorcer. Ils divorcèrent au grand étonnement de tout le village où cela ne s’était jamais vu. Après quoi Pierre Peigner revint chez Marie et continua à travailler le bout de terrain et à rapporter à Marie l’argent qu’il gagnait ici et là. Mais il avait des idées sur l’honneur et il ne voulait pas que les gosses que Marie pourrait avoir portassent son nom.
La baraque en vieilles planches ne devint jamais une jolie maison, il n’y eut ni fleurs, ni jet d’eau, ni gravier… Mais dans cette cabane sans eau, ni lumière, avec les rats qui passaient sur les visages des dormeurs, Marie était heureuse.
Les enfants de Marie étaient des enfants bien élevés, bien sages et bien polis, ils disaient toujours « Bonjour, Madame », « Merci, Monsieur ». Marie avait la main leste et dure et les enfants étaient habitués à obéir à ses ordres. La première excursion indépendante que la petite Martine fit dans les grands bois environnants se termina par une fessée magistrale. Partie tôt le matin, elle s’était perdue, et elle était restée dans les bois toute la journée, la nuit qui suivit, le jour et encore la nuit. Quand on la trouva elle dormait sur la mousse au pied d’un grand chêne. Dans le village on ne l’appelait plus que Martine-perdue-dans-les-bois. Les gens s’étonnaient : une petite fille bien courageuse. Deux jours et deux nuits seule dans les bois ! Une autre, on l’aurait trouvée épuisée de faim, en larmes. Elle, point du tout ! Quand elle a été réveillée dans le noir par tous ces gens avec les chiens et les lanternes, elle a tendu les bras à l’inconnu qui se penchait sur elle et s’est mise à rire. On avait parlé de son aventure dans les journaux locaux, et même dans les journaux de Paris. La fessée qui suivit cet exploit, Martine s’en souviendrait ! Elle était mémorable, et ne parut pourtant que naturelle à Martine, comme toutes les autres claques et fessées reçues. Comment Martine aurait-elle deviné que de se promener dans les bois et dormir sous un arbre entraînerait une pareille raclée. Pourquoi la mère tout en la fessant pleurait-elle et riait-elle en même temps ? Tandis que les gens du village semblaient au contraire contents de ce qu’elle avait fait, et, quand, avec ses cinq ans, traînant un cabas plus gros que sa petite personne, elle venait aux commissions[20], c’était souvent qu’on lui donnait une sucette, un fruit, une tablette de chocolat, et des sourires, et des tapes amicales, et des caresses. Elle était si gentille, si mignonne, bronzée, avec ses mèches noires et plates qui pendaient droit autour d’un étrange petit visage, comme on n’en voyait point dans le pays. Gentille, gentille comme un petit animal exotique, et réfléchie avec ça, une vraie petite femme ! Un jour de grande chaleur, lorsque sa mère lui avait ramassé toutes ses mèches sur le sommet de la tête, en chignon comme une dame, avec des épingles à cheveux, le village entier a ri, amoureux de cette Martine-perdue-dans-les-bois. De qui tenait-elle ?[21] On se mettait à rêver au père, on n’avait pourtant pas souvenir d’avoir vu passer dans les parages[22] quelqu’un venant des colonies, un jaune, un noir… De qui tenait cet enfant ?
Martine grandissait. Elle ne comprenait pas pourquoi les draps sales, les rats la faisaient vomir de temps en temps.
Sa longue promenade dans les bois s’expliquait par le fait que Martine se sentait toujours mal dans la cabane et avec sa famille.
Martine ne ressemblait pas à ses frères et à sa sœur et c’était peut-être pour cela qu’ils l’évitaient. Ils jouaient sans Martine, ne partageaient rien avec elle, et la traitaient en étrangère[23]. Martine ramassait tout ce qui brillait, ce qui avait de la couleur, ce qui était lisse et verni, billes, galets, boîtes de conserves bien lavées… Elle ne donnait jamais ces choses à ses frères. En même temps il lui arrivait de donner les jouets que la commune distribuait à la Noël[24], et que la mère allait chercher à la mairie. Marie n’y menait pas les enfants : se donner la peine de les laver, de les nettoyer. Elle distribuait ensuite les jouets aux enfants. Lorsque Martine recevait, par exemple, un petit nécessaire de couture, elle le donnait à sa sœur Francine, et ne demandait rien en échange. Francine savait coudre des boutons aux culottes des petits, elle savait moucher ses petits frères et leur donner des taloches, une vraie mère, même si elle n’avait jamais su apprendre ni à lire, ni à écrire. Martine, à l’école, apprenait tout, sa mémoire était fabuleuse, mais il aurait été vain de lui demander de donner la bouillie au plus petit, pendant que la mère allait aux commissions, la bouillie, elle l’oubliait… L’année où Fancine allait déjà à l’école – et Marie avait naturellement compté sur Martine pour remplacer l’aînée auprès des petits – fut désastreuse. Martine n’avait pas plus d’esprit de responsabilité que le plus petit des petits dans ses langes, elle laissa les gosses s’ébouillanter gravement, lâcher le chien qui ne revint jamais, noyer le chat dans le puits… A vrai dire, à peine la mère avait-elle le dos tourné que Martine s’enfuyait. Elle n’avait ni fibre maternelle, ni fibre familiale.
Et toujours première en classe, tous les prix… Tellement en avance sur les autres enfants que cela creusait un fossé entre eux et elle. Non qu’on la maltraitât[25], elle ne restait pas seule dans un coin… Simplement, elle ne formait pas corps avec eux[26].
Et pourtant, ce que Martine apprenait avec cette facilité surprenante ne l’intéressait point. D’une part, elle ne pouvait faire autrement que de retenir les choses qu’elle apprenait, elles lui collaient à la mémoire, et d’autre part, elle avait le goût du travail proprement fait, elle ne pouvait supporter les ratures, les pâtés d’encre, les coins retournés des cahiers, des livres lui faisaient mal. Les siens étaient si bien tenus qu’on les aurait crus tout neufs, sortant de la papeterie.
La maîtresse d’école était dans le pays depuis un quart de siècle, et elle permettait aux enfants Peigner et Vénin de faire leurs devoirs après la classe, à l’école, parce qu’elle ne connaissait que trop bien Marie et la cabane. Mais il y avait des moments où Marie disait aux gosses : « Vous rentrerez tantôt, qu’est-ce que c’est que ces façons de rester à l’école après la classe ! D’ici là que j’aille dire deux mots[27] à la maîtresse… » Alors, rentrée dans la baraque, Martine devenait embêtante : elle prenait toute la place sur la table, y étalait un vieux journal pour poser ses cahiers, et il ne fallait pas que les petits s’avisassent de la pousser, de faire trembler la table… Martine faisait régner la terreur, et si, elle, elle ne criait pas, elle avait la main aussi leste et aussi dure que la mère. Du reste, elle faisait ses devoirs en un clin d’œil[28] et se mettait aussitôt dans un coin à ne rien faire, yeux fermés, ou partait traîner dans les rues du village.
Ses cahiers et ses livres, elle les plaçait sur le haut du buffet où ils semblaient le plus en sécurité. Le jour où elle découvrit que les rats les avaient dans la nuit grignotés Martine ne dit rien. Elle posa les cahiers sur la table et les regarda. Mais lorsque les trois petites grenouilles, ses jeunes frères, curieux de constater ce que les rats avaient fait aux cahiers, grimpèrent sur le banc et la table et renversèrent dessus une bouteille d’huile, Martine devint folle à lier[29]. Elle criait, elle hurlait, tapait des pieds. C’était un extraordinaire déchaînement de désespoir et de rage. Enfin elle se jeta sur le lit de sa mère. Marie lui apporta un verre d’eau… Soudain, très calme, Martine se leva, prit ses cahiers et ses livres, déchirés, pleins de taches grasses, les déchira en petits morceaux et jeta le tout dans le feu de la cuisinière.
Elle qui n’était jamais en retard, elle arriva à l’école quand la classe avait commencé. Tout le monde la regardait : elle gagna sa place et dit calmement : « J’ai perdu mon cartable avec tous les livres et les cahiers… » Elle était pâle. La maîtresse soupçonnant quelque drame dans la cabane, dit simplement : « Bon, je suppose que ce n’est pas de ta faute… On tâchera de t’en procurer d’autres… Je continue la dictée… » La voisine de Martine, une petite blonde, Cécile Donzert, la fille de la coiffeuse, lui souffla : « Je t’en donnerai un, le cahier d’avant-guerre, un beau… viens à la maison après la classe… » Ce fut là le début d’une amitié pour la vie.
III. LES FONTS BAPTISMAUX
[30] DU CONFORT MODERNE
Mme Donzert, la coiffeuse, n’accepta pas d’emblée que sa fille fréquentât la fille de Marie Vénin. Elle avait pourtant de la sympathie pour la petite Martine-perdue-dans-les-bois, depuis que celle-ci, encore avant-guerre, toute petite, était venue lui acheter une savonnette. Mme Donzert le lui avait, en fait, donné, ce savon à la violette que Martine avait longuement choisi, ce n’était pas avec les trois sous qu’elle lui tendait, qu’elle aurait pu acheter quoi que ce fût, mais c’était pain bénit[31] que d’introduire un savon dans la maison Marie Vénin. Seulement lorsqu’il s’agit d’accueillir cette fille devenue grande, chez soi, à la maison… Mme Donzert était une catholique fervente et une brave femme, elle pensa que c’était son devoir d’aider la fille d’une pécheresse – cette malheureuse enfant qui étudiait si bien – à devenir une femme honnête malgré le milieu dont elle sortait. Il n’y avait rien à craindre pour Cécile, la plus sage, la moins cachottière des fillettes. Ce premier soir, Mme Donzert avait donné à Martine le beau cahier d’avant-guerre que Cécile lui avait promis, et l’avait gardée à dîner. Martine avait alors onze.
Depuis, en trois ans, elle était devenue comme la fille adoptive de la maison. Et même elle appelait Mme Donzert : « M’man Donzert », ce qui lui était venu tout naturellement et exprimait bien leurs rapports…
La toute première fois que Martine avait pénétré dans la maison à étage de Mme Donzert, elle en avait perdu la parole pour la journée. Aucun Palais de « Mille et une Nuits »[32] n’a jamais bouleversé ainsi un être humain. Lorsque Cécile s’était mise à ramener Martine de plus en plus souvent et à insister pour que Martine restât manger et coucher, Mme Donzert avait imposé une règle : il fallait que Martine prît tout d’abord un bain. Mme Donzert se méfiait de ce qu’elle pourrait apporter de la cabane de Marie, bien que la petite semblât toujours bien propre.
Lorsque Martine vit pour la première fois la baignoire, et que Cécile lui dit de se tremper dans toute cette eau, elle fut prise d’une émotion qui avait quelque chose de sacré, Comme si elle allait être baptisée… « Le confort moderne » lui arriva dessus d’un seul coup, avec l’eau courante, la canalisation, l’électricité… Elle ne s’y habitua jamais tout à fait et chaque fois que Mme Donzert lui disait : « Va prendre ton bain… » elle éprouvait une petite émotion délicieuse.
Le soir où sa mère lui avait conseillé d’aller coucher ailleurs, vue l’arrivée possible du père, Martine avait frappé à la fenêtre, la coiffeuse avait ouvert et dit :
– Entre, ma fille… Cécile est en train de prendre son bain… Ça va être ton tour. Je vais vous monter une infusion[33] quand vous serez au lit. Assieds-toi donc !
Martine s’assit sagement à côté de la coiffeuse devant la table de la salle à manger. Mme Donzert épluchait un journal de mode[34]. Ses mains roses et blanches tournaient délicatement les pages :
– Tiens, dit-elle, c’est joli ça… le petit tailleur. Il t’irait bien… – Elle jeta un regard sur Martine : ta robe te serre. S’il y a assez dans les coutures, il faut l’élargir.
– C’est parce que je l’ai lavée, M’man Donzert, elle a rétréci…
– C’est plutôt toi qui as gonflé[35], ma fille !
Cécile apparut dans un peignoir rose, toute rose elle-même, avec les yeux bleus de sa mère. – Martine, dépêche-toi, on monte !
Les murs de la salle de bains étaient blancs, le carrelage par terre, le tabouret en tube métallique… Martine trempa avec délectation dans l’eau chaude. Elle savonna une jambe, puis une autre.
L’émail de la baignoire était lisse, lisse, l’eau était douce, douce, le savon tout neuf faisait de la mousse nacrée. Une éponge rose et bleu ciel… Le globe laiteux éclairait chaque recoin de la salle de bains.
Mme Donzert criait d’en bas : « Martine, tu vas t’enlever la peau, à force de frotter… Assez ! » La sortie-de-bain, posée sur le radiateur était chaude, bleu ciel.
Martine, ses cheveux noirs ramassés en chignon sur la tête descendit l’escalier et alla se mettre sur un petit canapé à côté de Cécile, devant le feu. Elles balançaient leurs pieds nus et bavardaient à perdre haleine[36]. Ces deux-là, jamais elles ne se disputaient, et jamais il n’y avait eu entre elles le moindre nuage.
Mme Donzert posa les tasses sur le plateau :
– On monte, dit-elle.
Les deux lits jumeaux étaient faits. Des taies brodées de la main de Cécile, elle adorait broder. Mme Donzert leur fit promettre qu’elles n’allaient pas bavarder la moitié de la nuit, à leur habitude. Non, juste le temps de prendre l’infusion. Elles éteignirent. Puis elles se mirent à parler de Daniel. Il n’y avait pas de Daniel dans la vie de Cécile, d’un an l’aînée de Martine. Jusqu’à présent elle partageait les émotions de Martine. Daniel était chez son père et se préparait au concours de l’École d’Horticulture de Versailles[37] – on y recevait sans le bac[38], mais le concours était si difficile qu’il en fallait savoir plus que pour passer le bac, et avec des connaissances spéciales que le lycée, de toute façon, ne vous donnait pas. Martine rapportait toutes ces nouvelles, mot pour mot, du bureau de tabac[39], où elle avait entendu le garde-champêtre parler devant le zinc[40]. Elle y était venue acheter des allumettes pour sa mère.
Les jeunes filles parlaient toujours : quand Daniel arriverait-il au village ? Son oncle était mort, ses cousins travaillaient-ils à la pépinière. Il n’y avait rien pour l’attirer au village. La baignade seule peut-être, il fallait attendre l’été. Elles parlaient, elles parlaient.
IV. L’EMBRASEMENT
C’était la fin des études pour Martine, l’institutrice avait essayé de la persuader de continuer, si elle avait le brevet supérieur[41], elle aurait plus de chances de réussite dans la vie… Non, Martine ne voulait pas en entendre parler et puisque M’man Donzert était d’accord, Martine resterait chez elle et y apprendrait le métier de coiffeuse.
Quand Martine avait quelque chose en tête… Maintenant qu’elle avait terminé l’école et qu’elle allait travailler au « salon de coiffure », sa mère n’avait plus rien à dire, c’était régulier. Mme Donzert vint en personne à la cabane et dit à Marie qu’elle aimerait prendre Martine en apprentissage : Martine serait logée, nourrie et habillée, ensuite on verrait, selon ses dispositions… Elle aurait ses dimanches pour aller voir la famille. Mme Donzert, assise devant la table, dans la cabane, essayait d’avaler le café que Marie avait fait spécialement pour elle. Francine, l’aînée, revenait du sana[42]. A la voir si pâle, la poitrine creuse, des rides comme une vieille, on se demandait pourquoi on ne l’y avait pas gardée ? Elle tenait par la main le dernier-né, un petit frère qui ne savait pas encore marcher, les quatre autres, avec sur le dos des loques, restaient à distance, épiant Mme Donzert avec curiosité. Ils étaient sales, mais ne semblaient pas malheureux, et on avait envie de rire en les regardant, tant ils étaient drôles avec leurs faces de grenouilles réjouies. Jamais Mme Donzert n’avait vu un pareil intérieur, une poubelle était un jardin parfumé à comparer à ce lieu. Martine, la malheureuse enfant, ne lui en fut que plus chère. Marie et la marmaille accompagnèrent Mme Donzert jusqu’au portillon. « Fais bonjour à Madame… »[43] disait Francine au tout-petit. Il remua une petite main dans la direction de Mme Donzert. Mme Donzert sortit de cet univers toute bouleversée.
« C’est entendu, dit-elle à Martine, ta mère m’autorise à te prendre en apprentissage. Tu pourras aller lui dire bonjour le dimanche… » Et elle monta se changer.
C’est ainsi que Martine passa d’un univers à l’autre. Elle faisait maintenant de droit partie de la maison[44] de Mme Donzert.
La coiffeuse était veuve. Une photo agrandie de son mari occupait la place d’honneur au-dessus de la cheminée. Il était menuisier dans le pays et gagnait bien sa vie. Parisienne, elle avait d’abord souffert de se trouver comme ça dans la paix des champs, mais Cécile était née et elle s’était habituée à ce calme. Après la mort de son mari, elle avait vendu l’atelier qui se trouvait à quelques pas de la maison, remis à neuf son salon de coiffure, fait venir un appareil moderne pour la permanente, si bien que même les Parisiennes en villégiature venaient se coiffer chez elle. Pendant les mois de vacances, le salon ne se désemplissait pas et l’aide de Martine n’était pas de trop. Dès ce premier été, elle avait appris à faire le shampooing sur les têtes de Mme Donzert et de Cécile, mais Mme Donzert ne prenait pas de risque, et elle laissait Martine d’abord s’habituer au salon, à la clientèle, lui faisait balayer les cheveux coupés, nettoyer et astiquer émail et nickel – et dans l’astiquage Martine était inégalable – il fallait voir comment tout cela brillait ! Elle savait aussi sourire à la clientèle, silencieuse et affable, habillée d’une blouse blanche. Mme Donzert, qui croyait faire une bonne action, avait fait une bonne affaire. Cécile tenait le ménage, faisait la cuisine, elle n’aimait pas s’occuper du salon, et allait suivre des cours complémentaires à R. : il lui fallait le brevet supérieur, si elle voulait ensuite apprendre la sténodactylo à Paris.
Mme Donzert faisait des affaires d’or ; elle dut installer le deuxième lavabo pour les shampooings et acheter un autre séchoir. Bientôt elle fut obligée de confier à Martine même les permanentes sinon la coupe… et Marine se débrouillait fort bien.
Tous les mois, Mme Donzert se rendait à Paris. Il lui arrivait de rester coucher chez une cousine. Il fallait renouveler les stocks du savon, et acheter ce dont ses filles et elle-même pouvaient avoir besoin. Elle disait et pensait mes filles, au pluriel, ne distinguant plus entre elles, les habillant souvent pareil, admirant autant sa petite blonde-tendre que Martine. Cécile ressemblait à sa mère, sauf qu’elle était toute mince, mince comme sa mère avait dû être à son âge, tandis que maintenant Mme Donzert était grassouillette, gourmande et n’aimait pas se priver[45]. Et elle et Cécile étaient des cordons bleus[46].
Cécile avait un petit amoureux qui, lui aussi, allait à R… pour son travail, et ils faisaient tous les jours le chemin ensemble, en car ou à pied. Mme Donzert trouvait qu’ils étaient trop jeunes pour se marier, ce qui était vrai. L’amoureux avait dix-huit ans et était compagnon chez un maçon, mais les parents avaient de quoi[47], son père était entrepreneur maçon. Le petit devait apprendre le métier pour être patron : c’est indispensable pour savoir ensuite faire faire le travail aux autres. Cécile avait le droit de fréquenter Paul.
Martine n’avait pas d’amoureux, elle pensait à Daniel et continuait à vivre dans l’attente. Elle n’avait pas eu à attendre la reprise de la baignade. Tout d’abord Daniel faisait des visites régulières chez le docteur Foisnel : être condamné à mort à dix-huit ans, cela vous secoue l’organisme. Deux fois par semaine, Daniel venait chez le docteur pour des piqûres et il rencontrait toujours sur son chemin, à l’entrée du village assise sur une borne, Martine-perdue-dans-les-bois. Ce n’était pas sorcier de deviner pourquoi elle était là… Pourtant, Daniel passait sur son vélo, avec un sourire dans sa direction et même pas un bonjour.
Pour le retour il arrivait à Martine de le rater, ou le docteur le gardait à dîner, ou il filait sur Paris… A le voir comme ça sur son vélo, on n’aurait pas cru vraiment qu’il avait besoin de piqûres ! Changé, c’est vrai, un homme, mais toujours robuste, comme il l’avait été gamin. Il était net, luisant et solide, comme sa moto neuve – car bientôt il eut une moto. Martine l’entendait venir de loin sur la route, et c’était merveilleux et effrayant.
En été le promis de Cécile avait beaucoup de travail, toujours sur un chantier ou un autre, et elles allaient à la baignade toutes les deux, sans garçons. Naturellement là-bas, elles en rencontraient, mais on savait qu’elles étaient sérieuses et personne ne leur manquait de respect.
La baignade se trouvait entre R… et le village : c’était un grand étang dans le bois. La municipalité de R… avait fait construire les cabines. Pendant les vacances, surtout le dimanche la baignade était envahie. Des voitures arrêtées, des tentes de campeurs, des gens qui mangeaient sur l’herbe, leurs chiens qui couraient ici et là. Et après leur départ partout des papiers gras, des boîtes de conserves laissés par les pique-niqueurs.
On pouvait aller au bal à R… il y avait un dancing en plein air, mais Mme Donzert ne voulait pas que les petites y allassent seules, elles y allaient seulement quand Mme Donzert les accompagnait elle-même ou la pharmacienne, une femme sérieuse. Depuis l’été 1946 il y avait deux innovations : l’embrasement du château historique[48], un château auquel on était si habitué qu’on ne le remarquait plus et qui devenait dans cette robe de bal qu’on lui mettait pour un soir, beau, solennel, inaccessible derrière sa grille forgée. Les indigènes, les touristes, les estivants, accrochés à cette grille regardaient longuement cette apparition lumineuse. L’autre innovation était l’élection de Miss Vacances au cours du bal : un jury, élu parmi les personnalités de l’assistance, s’était trouvé composé d’un châtelain – pas celui de ce château historique là, mais d’un autre non moins historique – d’une vedette de cinéma, qui avait acheté une ferme aux environs de R… d’un membre du Conseil municipal de R… d’un des députés du département, etc. Les jeunes filles de R… et d’ailleurs ne rêvaient pas de monter sur l’estrade à côté de l’orchestre, alors on allait les pêcher parmi le public. C’est ainsi qu’un soir Martine, traînée de force, se trouva parmi d’autres, auprès du jury souriant, et devant le public riant et applaudissant chaque nouvelle candidate qui apparaissait là-haut… Chaque candidate devait sortir du rang et faire quelques pas sur l’estrade, accompagnée des commentaires du speaker à son micro.
Le public, ravi de la nouveauté du jeu, s’amusait énormément, et les garçons au fond de la salle faisaient un chahut qui couvrait l’orchestre lorsque les filles qu’ils connaissaient depuis toujours apparaissaient l’une après l’autre dans les feux de la rampe. Martine remporta la victoire. Elle avait une robe blanche, une jupe plissée. Sans fards ses traits se dessinaient nettement de loin. Mme Donzert et Cécile dans la salle regardaient Martine, bouleversées, émues, le cœur battant. Cécile n’était ni envieuse, ni jalouse. Mais le comble de cette soirée inoubliable fut la rencontre…
C’était à la sortie, tard, comme Martine seule, à la grille devant le château embrasé, attendait le pharmacien qui devait les ramener au village et cherchait sa voiture, pendant que sa femme et Mme Donzert plus fatiguées de regarder danser les filles que si elles avaient dansé elles-mêmes, s’étaient assises quelque part sur le banc, et que Cécile était ailleurs avec son amoureux. Cela arriva au moment même où l’embrasement s’éteignit : la silhouette de Daniel surgit dans la nuit à côté de Martine… Il avait comme toujours sa moto à la main, il souriait.
– Martine, dit-il tout bas, je me perdrais bien dans les bois avec toi…
Martine ! Martine ! criait-on. Où es-tu ? On t’attend !
Daniel enfourcha sa moto, leva le bras en signe d’adieu… La moto fila dans un bruit de tonnerre.