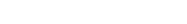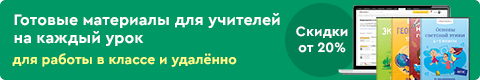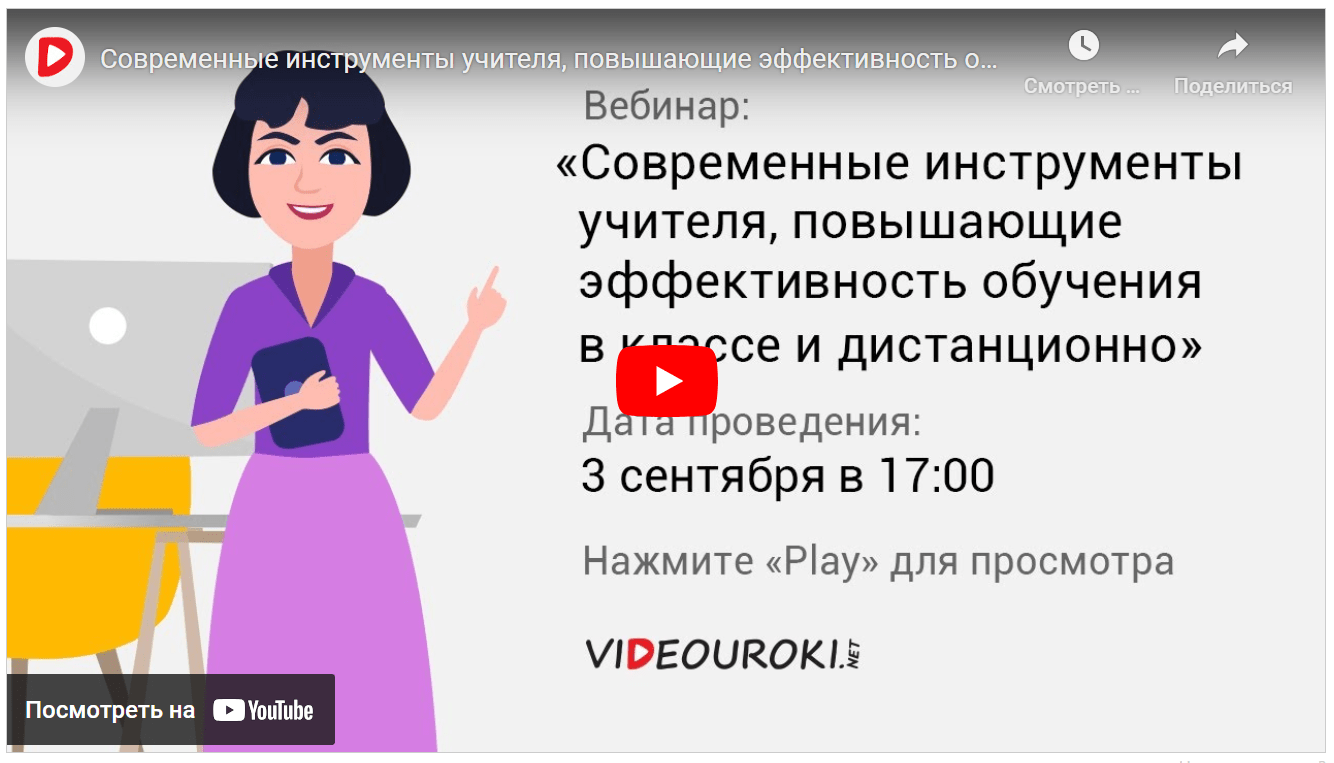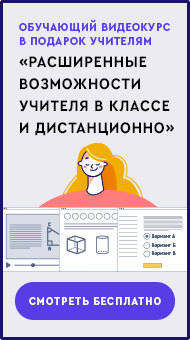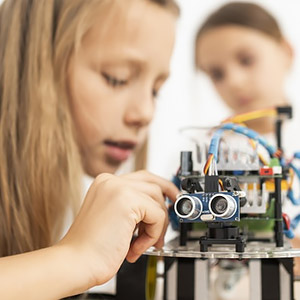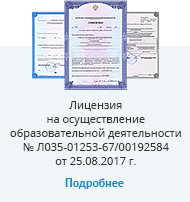André Gide. Isabelle
I. Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Qui est André Gide?
2. Comment étaient son enfance et sa jeunesse ?
3. Quelles contradictions dechiraient André Gide?
4. Quels regards politiques avait-il ?
5. Quels ouvrages a-t-il écrits?
André Gide (1869-1951)
André Gide est né en 1869 dans une famille de la haute bourgeoisie protestante . Son père est un brillant professeur à la faculté de droit de Paris, et sa mère, la fille d'un industriel rouennais du textile. André Gide est élevé dans une atmosphère puritaine. Petit garçon émotif et de santé fragile, il est sujet à des crises nerveuses répétées qui lui valent de nombreuses cures. André Gide est très affecté de perdre, à 11 ans, son père, cet être érudit et généreux qu'il admire. C'est son premier "Schaudern" ( "frissonner d'épouvante"). Il sera élevé au milieu de femmes, au premier rang desquelles : sa mère, Anna Schackleton, l'ancienne gouvernante de celle-ci, la bonne, ses tantes et ses trois cousines.
A treize ans, lors d'un séjour à Rouen, André Gide découvre sa cousine Madeleine (âgée de 16 ans) en pleurs et en prière du fait de l'inconduite conjugale de sa mère, la tante Mathilde. C'est son second Schaudern : "Je sentais que dans ce petit être, que déjà je chérissais, habitait une grande , une intolérable tristesse, un chagrin, tel que je n'aurais pas trop de tout mon amour, toute ma vie pour la guérir..." . Le jeune André Gide prend ainsi conscience du sentiment amoureux qu'il éprouve pour sa cousine.
Très tôt Gide fréquente des cercles littéraires, en particuliers celui des milieux symbolistes. Il publie alors, à compte d'auteur , Les Cahiers d'André Walter . Sa cousine, Madeleine, à qui il a offert le premier exemplaire, refuse le mariage. " Je protestai que je ne considérais pas son refus comme définitif, que j'acceptais d'attendre, que rien ne me ferait renoncer " .
Gide, du petit garçon fragile qu'il était, est devenu une sorte d'esthète, de Narcisse, très influencé par la littérature contemporaine.
Peu après la mort de sa mère, en 1895, Gide épouse sa cousine Madeleine , pour qui il éprouve depuis l'âge de quinze ans, une profonde affection. Mariage blanc et qui le restera : "C'est le ciel que mon insatiable enfer épousait."
Toute la vie de Gide est aimantée entre le ciel et l'enfer, entre la liberté et la contrainte morale, entre l'ange et le diable; il semble écartelé entre les extrêmes, déchiré entre les contradictions. Ainsi l'austérité de La Porte Etroite répond à l'Immoraliste (1902) et Saül (1903) est un écho aux Nourritures terrestres (1897).
En 1909, Gide fonde la NRF avec Copeau et Schlumberger. Cette revue imposera peu à peu une école de la rigueur et du classicisme, avec des écrivains comme Gide lui-même, Proust, Alain-Fournier, Giraudoux, Martin du Gard, ou Valéry. Puis Gide rompt avec le catholicisme. En 1919, Gide publie la Symphonie Pastorale. Puis de 1920 à 1925 Gide va connaître "une triple libération" : "libération du passé dans Si le grain ne meurt (1926), souvenirs d'enfance et de jeunesse, où il pousse la confession jusqu'à son point extrême; libération de la contrainte morale, dans le Corydon (1924), apologie ouverte de l'homosexualité; libération artistique aussi, la plus féconde, dans les Faux-Monnayeurs (1925)".
Puis Gide s'engage contre le colonialisme après un voyage au Congo ( 1925-1926) ; en faveur de la paix ( il assiste au congrès mondial de la paix en 1932) , et enfin dans le communisme , qu'il abandonnera dans la douleur suite à un voyage décevant en URSS (1936).
La mort de son épouse en 1938 l'amène à tirer un premier bilan de son existence. Il commence à publier son Journal (1889-1939) .
Lors de l'occupation allemande, Gide séjournera sur le continent africain. Au retour de la guerre, il renoue avec un personnage qui le hante depuis longtemps : Thésée, l'aventurier auquel , il s'identifie, malgré ses apparentes allures de moraliste.
En 1947, André Gide obtient le prix Nobel de littérature (sixième écrivain français à être couronné depuis 1901).
Il adapte ensuite le Proçès de Kafka que Jean-Louis Barrault mettra en scène , en 1947, au Théâtre Marigny.
André Gide est mort le 19 février 1951 d'une congestion pulmonaire. Il eut ces derniers mots mystérieux : " J'ai peur que mes phrases ne deviennent grammaticalement incorrectes. C'est toujours la lutte entre le raisonnable et ce qui ne l'est pas ..."
II. Lisez le résumé et répondez aux questions :
1. Où et quand se déroule l’action de ce roman ?
2. Quel est le sujet du roman ?
3. Quels sont les problèmes essentiels qui y sont soulevés ?
4. Qui sont les personnages du roman ?
Isabelle
C'est au château de la Quartfourche que débarque, à l'improviste, un jeune étudiant-chercheur, Gérard Lacase, qui, pour sa thèse sur Bossuet, attend beaucoup des conseils de l'érudit M. Floche et des documents précieux que celui-ci détient.
Mais bientôt le jeune homme oublie Bossuet pour laisser vagabonder son esprit sur le destin hors série d'une jeune femme très belle, Isabelle de Saint-Auréol, qui s'est enfuie du château en y laissant un fils infirme, Casimir. Ce dernier est élevé par un précepteur en soutane.
L'étudiant devient amoureux de l'image de cette Isabelle qu'il a reconstituée de toutes pièces à partir des bribes de confidences glanées ici et là ; cette Isabelle qu'il aperçoit par hasard un jour où elle vient, en cachette de son fils, rendre visite à sa famille.
Mais il ne parvient pas à lui parler. Longtemps après, il la retrouve, toujours au château qu'elle a hérité à la mort de ses parents et qu'elle va vendre. C'est une aventurière sans scrupule et quelque peu criminelle qui ne vivait que des sommes extorquées aux auteurs de ses jours.
Dans ce bref récit, sobre et dépouillé dans la forme, André Gide n'a pas cru bon de décrire jusque dans le détail la psychologie de ses personnages ou les mobiles de leurs actes. Il s'est souvent contenté d'une silhouette caricaturale pour évoquer les hôtes poussiéreux du château de la Quartfourche. La morale de l'histoire, sans prétention ni originalité retient moins qu'une certaine perfection classique du récit.
III. Lisez le fragment du roman et répondez aux questions : 1. Où et quand se déroule l’action de cet extrait ?
2. Quels sont les problèmes qui y sont soulevés ?
3. Qui est le narrateur ? Quelles étaient ses préoccupations ?
4. Qu’est-ce qui lui a été offert par M. Desnos ?
5. Qui est M. Floche ?
6. Quelles étaient les espérences du jeune homme ?
7. Comment étaient ses impressions à l’arrivée à la station du Breuil-Blangy ?
Comment était la calèche venue à sa rencontre ?
8. Qu’est qu’il a appris du cocher ? 9. Comment était le trajet et l’arrivée au château ?
10. Comment était le dîner et la conversation avec Mademoiselle Verdure ?
11. Qui est venu pendant le dîner ? Comment était-il ?
12. Comment était la conversation à propos du premier déjeuner de Monsieur Lacase ?
13. Qu’est-ce qu’on apprend de la part de Monsieur l’abbé ?
14. Comment était préparée la chambre de M.Lacase ?
15. Comment était le matin ? Quel enfant était vu par M. Lacase ?
16. Comment étaient les maîtres du château ?
17. Qu’est-ce qui a gêné M. Lacase ? Qui lui est devenu antipathique ?
18. De quoi parlaient Monsieur Floche et M. Lacase ?
19. Сomment M.Floche caractérisait son beau-frère, les habitudes d’ici, lui-même ?
Quels étaient ses intérêts ?
20. Comment était la bibliothèque de la Quartfourche ?
21. Que M.Floche a-t-il prêté à la disposition de M. Lacase ?
22. Comment a commencé le travail des scientifiques ?
23. Donnez les caractéristiques d’un des personnages de ces chapitres.
24. Quels détails ou faits ont une grande valeur dans la narration ?
I
J’ai presque peine à comprendre aujourd’hui l’impatience qui m’élançait alors vers la vie. À vingt-cinq ans je n’en connaissais rien à peu près, que par les livres; et c’est pourquoi sans doute je me croyais romancier; car j’ignorais encore avec quelle malignité les événements dérobent à nos yeux le côté par où ils nous intéressaient davantage, et combien peu de prise ils offrent à qui ne sait pas les forcer.
Je préparais alors, en vue de mon doctorat, une thèse sur la chronologie des sermons de Bossuet; non que je fusse particulièrement attiré par l’éloquence de la chaire: j’avais choisi ce sujet par révérence pour mon vieux maître Albert Desnos, dont l’importante Vie de Bossuetachevait précisément de paraître. Aussitôt qu’il connut mon projet d’études, M. Desnos s’offrit à m’en faciliter les abords. Un de ses plus anciens amis, Benjamin Floche, membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, possédait divers documents qui sans doute pourraient me servir; en particulier une Bible couverte d’annotations de la main même de Bossuet. M. Floche s’était retiré depuis une quinzaine d’années à la Quartfourche, qu’on appelait plus communément: le Carrefour, propriété de famille aux environs de Pont-l’Évêque, dont il ne bougeait plus, où il se ferait un plaisir de me recevoir et de mettre à ma disposition ses papiers, sa bibliothèque et son érudition que M. Desnos me disait être inépuisable.
Entre M. Desnos et M. Floche des lettres furent échangées. Les documents s’annoncèrent plus nombreux que ne me l’avait d’abord fait espérer mon maître; il ne fut bientôt plus question d’une simple visite: c’est un séjour au château de la Quartfourche que, sur la recommandation de M. Desnos, l’amabilité de M. Floche me proposait. Bien que sans enfant, M. et Madame Floche n’y vivaient pas seuls: quelques mots inconsidérés de M. Desnos, dont mon imagination
s’empara, me firent espérer de trouver là-bas une société avenante, qui tout aussitôt m’attira plus que les documents poudreux du Grand Siècle; déjà ma thèse n’était plus qu’un prétexte; j’entrais dans ce château non plus en scolar, mais en Nejdanof, en Valmont; déjà je le peuplais d’aventures. La Quartfourche! je répétais ce nom mystérieux: c’est ici, pensais-je, qu’Hercule hésite… Je sais de reste ce qui l’attend sur le sentier de la vertu; mais l’autre route?… l’autre route…
Vers le milieu de septembre, je rassemblai le meilleur de ma modeste garde-robe, renouvelai mon jeu de cravates, et partis.
Quand j’arrivai à la station du Breuil-Blangy, entre Pont-l’Évêque et Lisieux, la nuit était à peu près close. J’étais seul à descendre du train. Une sorte de paysan en livrée vint à ma rencontre, prit ma valise et m’escorta vers la voiture qui stationnait de l’autre côté de la gare. L’aspect du cheval et de la voiture coupa l’essor de mon imagination; on ne pouvait rêver rien de plus minable. Le paysan-cocher repartit pour dégager la malle que j’avais enregistrée; sous ce poids les ressorts de la calèche fléchirent. À l’intérieur, une odeur de poulailler suffocante… Je voulus baisser la vitre de la portière, mais la poignée de cuir me resta dans la main. Il avait plu dans la journée; la route était tirante; au bas de la première côte, une pièce du harnais céda. Le cocher sortit de dessous son siège un bout de corde et se mit en posture de rafistoler le trait. J’avais mis pied à terre et m’offris à tenir la lanterne qu’il venait d’allumer; je pus voir que la livrée du pauvre homme, non plus que le harnachement, n’en était pas à son premier rapiéçage.
– Le cuir est un peu vieux, hasardai-je.
Il me regarda comme si je lui avais dit une injure, et presque brutalement:
– Dites donc: c’est tout de même heureux qu’on ait pu venir vous chercher.
– Il y a loin, d’ici le château? questionnai-je de ma voix la plus douce. Il ne répondit pas directement, mais:
– Pour sûr qu’on ne fait pas le trajet tous les jours! – Puis au bout d’un instant:
– Voilà peut-être bien six mois qu’elle n’est pas sortie, la calèche…
– Ah!… Vos maîtres ne se promènent pas souvent? repris-je par un effort désespéré d’amorcer la conversation.
– Vous pensez! Si l’on n’a pas autre chose à faire!
Le désordre était réparé: d’un geste il m’invita à remonter dans la voiture, qui repartit.
Le cheval peinait aux montées, trébuchait aux descentes et tricotait affreusement en terrain plat; parfois, tout inopinément, il stoppait. – Du train dont nous allons, pensais-je, nous arriverons au Carrefour longtemps après que mes hôtes se seront levés de table; et même (nouvel arrêt du cheval) après qu’ils se seront couchés. J’avais grand-faim; ma bonne humeur tournait à l’aigre. J’essayai de regarder le pays: sans que je m’en fusse aperçu, la voiture avait quitté la grande route et s’était engagée dans une route plus étroite et beaucoup moins bien entretenue; les lanternes n’éclairaient de droite et de gauche qu’une haie continue, touffue et haute; elle semblait nous entourer, barrer la route, s’ouvrir devant nous à l’instant de notre passage, puis, aussitôt après, se refermer.
Au bas d’une montée plus raide, la voiture s’arrêta de nouveau. Le cocher vint à la portière et l’ouvrit, puis, sans façons:
– Si Monsieur voulait bien descendre. La côte est un peu dure pour le cheval. – Et lui-même fit la montée en tenant par la bride la haridelle. À mi-côte il se retourna vers moi, qui marchais en arrière:
– On est bientôt rendu, dit-il sur un ton radouci. Tenez: voilà le parc. Et je distinguai devant nous, encombrant le ciel découvert, une sombre masse d’arbres. C’était une avenue de grands hêtres, sous laquelle enfin nous entrâmes, et où nous rejoignîmes la première route que nous avions quittée. Le cocher m’invita à remonter dans la voiture, qui parvint bientôt à la grille; nous pénétrâmes dans le jardin.
Il faisait trop sombre pour que je pusse rien distinguer de la façade du château; la voiture me déposa devant un perron de trois marches, que je gravis, un peu ébloui par le flambeau qu’une femme sans âge, sans grâce, épaisse et médiocrement vêtue tenait à la main et dont elle rabattait vers moi la lumière. Elle me fit un salut un peu sec. Je m’inclinai devant elle, incertain…
– Madame Floche, sans doute?…
– Mademoiselle Verdure simplement. Monsieur et Madame Floche sont couchés. Ils vous prient d’excuser s’ils ne sont pas là pour vous recevoir; mais on dîne de bonne heure ici.
– Vous-même, Mademoiselle, je vous aurai fait veiller bien tard.
– Oh! moi, j’y suis faite, dit-elle sans se retourner.
Elle m’avait précédé dans le vestibule. – Vous serez peut-être content de prendre quelque chose?
– Ma foi, je vous avoue que je n’ai pas dîné.
Elle me fit entrer dans une vaste salle à manger où se trouvait préparé un médianoche confortable.
– À cette heure, le fourneau est éteint; et à la campagne il faut se contenter de ce que l’on trouve.
– Mais tout cela m’a l’air excellent, dis-je en m’attablant devant un plat de viande froide. Elle s’assit de biais sur une autre chaise près de la porte, et, pendant tout le temps que je mangeais, resta les yeux baissés, les mains croisées sur les genoux, délibérément subalterne. À plusieurs reprises, comme la morne conversation retombait, je m’excusai de la retenir; mais elle me donna à entendre qu’elle attendait que j’eusse fini pour desservir:
– Et votre chambre, comment feriez-vous pour la trouver tout seul?…
Je dépêchais et mettais bouchées doubles lorsque la porte du vestibule s’ouvrit: un abbé entra, à cheveux gris, de figure rude mais agréable.
Il vint à moi la main tendue:
– Je ne voulais pas remettre à demain le plaisir de saluer notre hôte. Je ne suis pas descendu plus tôt parce que je savais que vous causiez avec Mademoiselle Olympe Verdure, dit-il, en tournant vers elle un sourire qui pouvait être malicieux, cependant qu’elle pinçait les lèvres et faisait visage de bois: – Mais à présent que vous avez achevé de manger, continua-t-il tandis que je me levais de table, nous allons laisser Mademoiselle Olympe remettre ici un peu d’ordre; elle trouvera plus décent, je le présume, de laisser un homme accompagner Monsieur Lacase jusqu’à sa chambre à coucher, et de résigner ici ses fonctions.
Il s’inclina cérémonieusement devant Mademoiselle Verdure, qui lui fit une révérence écourtée.
– Oh! je résigne; je résigne… Monsieur l’abbé, devant vous, vous le savez, je résigne toujours… Puis revenant à nous brusquement: – Vous alliez me faire oublier de demander à Monsieur Lacase ce qu’il prend à son premier déjeuner.
– Mais, ce que vous voudrez, Mademoiselle… Que prend-on d’ordinaire ici?
– De tout. On prépare du thé pour ces dames, du café pour Monsieur Floche, un potage pour Monsieur l’abbé, et du racahout pour Monsieur Casimir.
– Et vous, Mademoiselle, vous ne prenez rien?
– Oh! moi, du café au lait, simplement.
– Si vous le permettez, je prendrai du café au lait avec vous.
– Eh! eh! tenez-vous bien, Mademoiselle Verdure, dit l’abbé en me prenant par le bras – Monsieur Lacase m’a tout l’air de vous faire la cour!
Elle haussa les épaules, puis me fit un rapide salut, tandis que l’abbé m’entraînait.
Ma chambre était au premier étage, presque à l’extrémité d’un couloir.
– C’est ici, dit l’abbé en ouvrant la porte d’une pièce spacieuse qu’illuminait un grand brasier. – Dieu me pardonne! on vous a fait du feu!… Vous vous en seriez peut-être bien passé… Il est vrai que les nuits de ce pays sont humides, et la saison, cette année, est anormalement pluvieuse…
Il s’était approché du foyer vers lequel il tendit ses larges paumes tout en écartant le visage, comme un dévot qui repousse la tentation. Il semblait disposé à causer plutôt qu’à me laisser dormir.
– Oui, commença-t-il, en avisant ma malle et mon sac de nuit, – Gratien vous a monté vos colis.
– Gratien, c’est le cocher qui m’a conduit? demandai-je.
– Et c’est aussi le jardinier; car ses fonctions de cocher ne l’occupent guère.
– Il m’a dit en effet que la calèche ne sortait pas souvent.
– Chaque fois qu’elle sort c’est un événement historique. D’ailleurs Monsieur de Saint-Auréol n’a depuis longtemps plus d’écurie; dans les grandes occasions, comme ce soir, on emprunte le cheval du fermier.
– Monsieur de Saint-Auréol? répétai-je, surpris.
– Oui, dit-il, je sais que c’est Monsieur Floche que vous venez voir; mais la Quartfourche appartient à son beau-frère. Demain vous aurez l’honneur d’être présenté à Monsieur et à Madame de Saint-Auréol.
– Et qui est Monsieur Casimir? dont je ne sais qu’une chose, c’est qu’il prend du racahout le matin.
– Leur petit-fils et mon élève. Dieu me permet de l’instruire depuis
rois ans. Il avait dit ces mots en fermant les yeux et avec une componction modeste, comme s’il s’était agi d’un prince du sang.
– Ses parents ne sont pas ici? demandai-je.
– En voyage. Il serra les lèvres fortement puis reprit aussitôt:
– Je sais, Monsieur, quelles nobles et saintes études vous amènent…
– Oh! ne vous exagérez pas leur sainteté, interrompis-je aussitôt en riant, c’est en historien seulement qu’elles m’occupent.
– N’importe, fit-il, écartant de la main toute pensée désobligeante; l’histoire a bien aussi ses droits. Vous trouverez en Monsieur Floche le plus aimable et le plus sûr des guides.
– C’est ce que m’affirmait mon maître, Monsieur Desnos.
– Ah! Vous êtes élève d’Albert Desnos? Il serra les lèvres de nouveau. J’eus l’imprudence de demander:
– Vous avez suivi de ses cours?
– Non! fit-il rudement. Ce que je sais de lui m’a mis en garde… C’est un aventurier de la pensée. À votre âge on est assez facilement séduit par ce qui sort de l’ordinaire… Et, comme je ne répondais rien: – Ses théories ont d’abord pris quelque ascendant sur la jeunesse; mais on en revient déjà, m’a-t-on dit.
J’étais beaucoup moins désireux de discuter que de dormir. Voyant qu’il n’obtiendrait pas de réplique:
– Monsieur Floche vous sera de conseil plus tranquille, reprit-il; puis, devant un bâillement que je ne dissimulai point:
– Il se fait assez tard: demain, si vous le permettez, nous trouverons loisir pour reprendre cet entretien. Après ce voyage vous devez être fatigué.
– Je vous avoue, Monsieur l’abbé, que je croule de sommeil.
Dès qu’il m’eut quitté, je relevai les bûches du foyer, j’ouvris la fenêtre toute grande, repoussant les volets de bois. Un grand souffle obscur et mouillé vint incliner la flamme de ma bougie, que j’éteignis pour contempler la nuit. Ma chambre ouvrait sur le parc, mais non sur le devant de la maison comme celles du grand couloir qui devaient sans doute jouir d’une vue plus étendue; mon regard était aussitôt arrêté par des arbres; au-dessus d’eux, à peine restait-il la place d’un peu de ciel où le croissant venait d’apparaître, recouvert par les nuages presque aussitôt. Il avait plu de nouveau; les branches larmoyaient encore…
– Voici qui n’invite guère à la fête, pensai-je, en refermant fenêtre et volets. Cette minute de contemplation m’avait transi, et l’âme encore plus que la chair; je rabattis les bûches, ranimai le feu, et fus heureux de trouver dans mon lit une cruche d’eau chaude, que sans doute l’attentionnée Mademoiselle Verdure y avait glissée.
Au bout d’un instant je m’avisai que j’avais oublié de mettre à la porte mes chaussures. Je me relevai et sortis un instant dans le couloir; à l’autre extrémité de la maison, je vis passer Mademoiselle Verdure. Sa chambre était au-dessus de la mienne, comme me l’indiqua son pas lourd qui, peu de temps après, commença d’ébranler le plafond. Puis il se fit un grand silence et, tandis que je plongeais dans le sommeil, la maison leva l’ancre pour la traversée de la nuit.
II
Je fus réveillé d’assez bon matin par les bruits de la cuisine dont une porte ouvrait précisément sous ma fenêtre. En poussant mes volets j’eus la joie de voir un ciel à peu près pur; le jardin, mal ressuyé d’une récente averse, brillait; l’air était bleuissant. J’allais refermer ma fenêtre, lorsque je vis sortir du potager et accourir vers la cuisine un grand enfant, d’âge incertain car son visage marquait trois ou quatre ans de plus que son corps; tout contrefait, il portait de guingois: ses jambes torses lui donnaient une allure extraordinaire: il avançait obliquement, ou plutôt procédait par bonds, comme si, à marcher pas à pas, ses pieds eussent dû s’entraver… C’était évidemment l’élève de l’abbé, Casimir. Un énorme chien de Terre-Neuve gambadait à ses côtés, sautait de conserve avec lui, lui faisait fête; l’enfant se défendait tant bien que mal contre sa bousculante exubérance; mais au moment qu’il allait atteindre la cuisine, culbuté par le chien, soudain je le vis rouler dans la boue. Une maritorne épaisse s’élança, et tandis qu’elle relevait l’enfant:
– Ah ben! vous v’la beau! Si c’est Dieu permis de s’met’ dans des états pareils! On vous l’a pourtant répété bien des fois d’quitter l’Terno dans la remise!… Allons! v’nez-vous en par ici qu’on vous essuie…
Elle l’entraîna dans la cuisine. À ce moment j’entendis frapper à ma porte; une femme de chambre m’apportait de l’eau chaude pour ma toilette. Un quart d’heure après, la cloche sonna pour le déjeuner.
Comme j’entrais dans la salle à manger:
– Madame Floche, je crois que voici notre aimable hôte, dit l’abbé en s’avançant à ma rencontre.
Madame Floche s’était levée de sa chaise, mais ne paraissait pas plus grande debout qu’assise; je m’inclinai profondément devant elle; elle m’honora d’un petit plongeon brusque; elle avait dû recevoir à un certain âge quelque formidable événement sur la tête; celle-ci en était restée irrémédiablement enfoncée entre les épaules; et même un peu de travers. Monsieur Floche s’était mis tout à côté d’elle pour me tendre la main. Les deux petits vieux étaient exactement de même taille, de même habit, paraissaient de même âge, de même chair… Durant quelques instants nous échangeâmes des compliments vagues, parlant tous les trois à la fois. Puis, il y eut un noble silence, et Mademoiselle Verdure arriva portant la théière.
– Mademoiselle Olympe, dit enfin Madame Floche, qui, ne pouvant tourner la tête, s’adressait à vous de tout le buste. – Mademoiselle Olympe, notre amie, s’inquiétait beaucoup de savoir si vous aviez bien dormi et si le lit était à votre convenance.
Je protestai que j’y avais reposé on ne pouvait mieux et que la cruche chaude que j’y avais trouvée en me couchant m’avait fait tout le bien du monde.
Mademoiselle Verdure, après m’avoir souhaité le bonjour, ressortit.
– Et, le matin, les bruits de la cuisine ne vous ont pas trop incommodé?
Je renouvelai mes protestations.
– Il faut vous plaindre, je vous en prie, parce que rien ne serait plus aisé que de vous préparer une autre chambre…
Monsieur Floche, sans rien dire lui-même, hochait la tête obliquement et, d’un sourire, faisait sien chaque propos de sa femme.
– Je vois bien, dis-je, que la maison est très vaste; mais je vous certifie que je ne saurais être installé plus agréablement.
– Monsieur et Madame Floche, dit l’abbé, se plaisent à gâter leurs hôtes.
Mademoiselle Olympe apportait sur une assiette des tranches de pain grillé; elle poussa devant elle le petit stropiat que j’avais vu culbuter tout à l’heure. L’abbé le saisit par le bras:
– Allons, Casimir! Vous n’êtes plus un bébé; venez saluer Monsieur Lacase comme un homme. Tendez la main… Regardez en face!… Puis se tournant vers moi comme pour l’excuser: – Nous n’avons pas encore grand usage du monde…
La timidité de l’enfant me gênait:
– C’est votre petit-fils? demandai-je à Madame Floche, oublieux des renseignements que l’abbé m’avait fournis la veille.
– Notre petit-neveu, répondit-elle; vous verrez un peu plus tard mon beau-frère et ma sœur, ses grands-parents.
– Il n’osait pas rentrer parce qu’il avait empli de boue ses vêtements en jouant avec Terno, expliqua Mademoiselle Verdure.
– Drôle de façon de jouer, dis-je, en me tournant affablement vers Casimir; j’étais à la fenêtre quand il vous a culbuté… Il ne vous a pas fait mal?
– Il faut dire à Monsieur Lacase, expliqua l’abbé à son tour, que l’équilibre n’est pas notre fort…
Parbleu! je m’en apercevais de reste, sans qu’il fût nécessaire de me le signaler. Ce grand gaillard d’abbé, aux yeux vairons, me devint brusquement antipathique.
L’enfant ne m’avait pas répondu, mais son visage s’était empourpré. Je regrettai ma phrase et qu’il y eût pu sentir quelque allusion à son infirmité. L’abbé, son potage pris, s’était levé de table et arpentait la pièce; dès qu’il ne parlait plus, il gardait les lèvres si serrées que celle de dessus formait un bourrelet, comme celle des vieillards édentés. Il s’arrêta derrière Casimir, et comme celui-ci vidait son bol: – Allons! Allons, jeune homme, Avenzoar nous attend!
L’enfant se leva; tous deux sortirent.
Sitôt que le déjeuner fut achevé, Monsieur Floche me fit signe.
– Venez avec moi dans le jardin, mon jeune hôte, et me donnez des nouvelles du Paris penseur.
Le langage de Monsieur Floche fleurissait dès l’aube. Sans trop écouter mes réponses, il me questionna sur Gaston Boissier son ami, et sur plusieurs autres savants que je pouvais avoir eus pour maîtres et avec qui il correspondait encore de loin en loin; il s’informa de mes goûts, de mes études… Je ne lui parlai naturellement pas de mes projets littéraires et ne laissai voir de moi que le sorbonnien; puis il entreprit l’histoire de la Quartfourche, dont il n’avait à peu près pas bougé depuis près de quinze ans, l’histoire du parc, du château; il réserva pour plus tard l’histoire de la famille qui l’habitait précédemment, mais commença de me raconter comment il se trouvait en possession des manuscrits du XVIIe siècle qui pouvaient intéresser ma thèse… Il marchait à petits pas pressés, ou, plus exactement, il trottinait auprès de moi; je remarquai qu’il portait son pantalon si bas que la fourche en restait à mi-cuisse; sur le devant du pied, l’étoffe retombait en nombreux
plis, mais par derrière restait au-dessus de la chaussure, suspendue à l’aide de je ne sais quel artifice; je ne l’écoutais plus que d’une oreille distraite, l’esprit engourdi par la molle tiédeur de l’air et par une sorte de torpeur végétale.
En suivant une allée de très hauts marronniers qui formaient voûte au-dessus de nos têtes, nous étions parvenus presque à l’extrémité du parc. Là, protégé contre le soleil par un buisson d’arbres-à-plumes, se trouvait un banc où Monsieur Floche m’invita à m’asseoir. Puis tout à coup:
– L’abbé Santal vous a-t-il dit que mon beau-frère est un peu…? Il n’acheva pas, mais se toucha le front de l’index.
Je fus trop interloqué pour pouvoir trouver rien à répondre. Il continua:
– Oui, le baron de Saint-Auréol, mon beau-frère; l’abbé ne vous l’a peut-être pas dit plus qu’à moi… mais je sais néanmoins qu’il le pense; et je le pense aussi… Et de moi, l’abbé ne vous a pas dit que j’étais un peu…?
– Oh! Monsieur Floche, comment pouvez-vous croire?…
– Mais, mon jeune ami, dit-il en me tapant familièrement sur la main, je trouverais cela tout naturel. Que voulez-vous? nous avons pris ici des habitudes, à nous enfermer loin du monde, un peu… en dehors de la circulation. Rien n’apporte ici de… diversion; comment dirais-je? oui. Vous êtes bien aimable d’être venu nous voir – et comme j’essayais un geste: – je le répète: bien aimable, et je le récrirai ce soir à mon excellent ami Desnos; mais vous vous aviseriez de me raconter ce qui vous tient au cœur, les questions qui vous troublent, les problèmes qui vous intéressent… je suis sûr que je ne vous comprendrais pas.
Que pouvais-je répondre? Du bout de ma canne je grattais le sable…
– Voyez-vous, reprit-il, ici nous avons un peu perdu le contact. Mais non, mais non! ne protestez donc pas; c’est inutile. Le baron est sourd comme une calebasse; mais il est si coquet qu’il tient surtout à ne pas le paraître; il feint d’entendre plutôt que de faire hausser la voix. Pour moi, quant aux idées du jour, je me fais l’effet d’être tout aussi sourd que lui; et du reste je ne m’en plains pas. Je ne fais même pas grand effort pour entendre. À fréquenter Massillon et Bossuet, j’ai fini par croire que les problèmes qui tourmentaient ces grands esprits sont tout aussi beaux et importants que ceux qui passionnaient ma jeunesse… problèmes que ces grands esprits n’auraient pas pu comprendre sans doute… non plus que moi je ne puis comprendre ceux qui vous passionnent aujourd’hui… Alors, si vous le voulez bien, mon futur collègue, vous me parlerez de préférence de vos études, puisque ce sont les miennes également, et vous m’excuserez si je ne vous interroge pas sur les musiciens, les poètes, les orateurs que vous aimez, ni sur la forme de gouvernement que vous croyez la préférable.
Il regarda l’heure à un oignon attaché à un ruban noir:
– Rentrons à présent, dit-il en se levant. Je crois avoir perdu ma journée quand je ne suis pas au travail à dix heures.
Je lui offris mon bras qu’il accepta, et comme, à cause de lui, parfois, je ralentissais mon allure:
– Pressons! Pressons! me disait-il. Les pensées sont comme les fleurs, celles qu’on cueille le matin se conservent le plus longtemps fraîches.
La bibliothèque de la Quartfourche est composée de deux pièces que sépare un simple rideau: une, très exiguë et surhaussée de trois marches, où travaille Monsieur Floche, à une table devant une fenêtre. Aucune vue; des rameaux d’orme ou d’aulne viennent battre les carreaux; sur la table, une antique lampe à réservoir, que coiffe un abat-jour de porcelaine vert; sous la table, une énorme chancelière; un petit poêle dans un coin, dans l’autre coin, une seconde table, chargée de lexiques; entre deux, une armoire aménagée en cartonnier. La seconde pièce est vaste; des livres tapissent le mur jusqu’au plafond; deux fenêtres; une grande table au milieu de la pièce.
– C’est ici que vous vous installerez, me dit Monsieur Floche; – et, comme je me récriais:
– Non, non; moi, je suis accoutumé au réduit; à dire vrai, je m’y sens mieux; il me semble que ma pensée s’y concentre. Occupez la grande table sans vergogne; et, si vous y tenez, pour que nous ne nous dérangions pas, nous pourrons baisser le rideau.
– Oh! pas pour moi, protestai-je; jusqu’à présent, si pour travailler j’avais eu besoin de solitude, je ne…
– Eh bien! reprit-il en m’interrompant, nous le laisserons donc relevé. J’aurai, pour ma part, grand plaisir à vous apercevoir du coin de l’œil. (Et, de fait, les jours suivants, je ne levais point la tête de dessus mon travail sans rencontrer le regard du bonhomme, qui me souriait en hochant la tête, ou qui, vite, par crainte de m’importuner, détournait les yeux et feignait d’être plongé dans sa lecture.)
Il s’occupa tout aussitôt de mettre à ma facile disposition les livres et les manuscrits qui pouvaient m’intéresser; la plupart se trouvaient serrés dans le cartonnier de la petite pièce; leur nombre et leur importance dépassait tout ce que m’avait annoncé M. Desnos; il m’allait falloir au moins une semaine pour relever les précieuses indications que j’y trouverais. Enfin M. Floche ouvrit, à côté du cartonnier, une très petite armoire et en sortit la fameuse Bible de Bossuet, sur laquelle l’Aigle de Meaux avait inscrit, en regard des versets pris pour textes, les dates des sermons qu’ils avaient inspirés. Je m’étonnai qu’Albert Desnos n’eût pas tiré parti de ces indications dans ses travaux; mais ce livre n’était tombé que depuis peu entre les mains de M. Floche.
– J’ai bien entrepris, continua-t-il, un mémoire à son sujet; et je me félicite aujourd’hui de n’en avoir encore donné connaissance à personne, puisqu’il pourra servir à votre thèse en toute nouveauté!
Je me défendis de nouveau:
– Tout le mérite de ma thèse, c’est à votre obligeance que je le devrai. Au moins en accepterez-vous la dédicace, Monsieur Floche, comme une faible marque de ma reconnaissance?
Il sourit un peu tristement:
– Quand on est si près de quitter la terre, on sourit volontiers à tout ce qui promet quelque survie.
Je crus malséant de surenchérir à mon tour.
– À présent, reprit-il, vous allez prendre possession de la bibliothèque, et vous ne vous souviendrez de ma présence que si vous avez quelque renseignement à me demander. Emportez les papiers qu’il vous faut… Au revoir!… et comme en descendant les trois marches, je retournais vers lui mon sourire, il agita sa main devant ses yeux: – À tantôt!
J’emportai dans la grande pièce les quelques papiers qui devaien
faire l’objet de mon premier travail. Sans m’écarter de la table devant laquelle j’étais assis, je pouvais distinguer Monsieur Floche dans sa portioncule: il s’agita quelques instants; ouvrant et refermant des tiroirs, sortant des papiers, les rentrant, faisant mine d’homme affairé… Je soupçonnais en vérité qu’il était fort troublé, sinon gêné par ma présence et que, dans cette vie si rangée, le moindre ébranlement risquait de compromettre l’équilibre de la pensée. Enfin il s’installa, plongea jusqu’à mi-jambes dans la chancelière, ne bougea plus…
De mon côté je feignais de m’absorber dans mon travail; mais j’avais grand-peine à tenir en laisse ma pensée; et je n’y tâchais même pas; elle tournait autour de la Quartfourche, ma pensée, comme autour d’un donjon dont il faut découvrir l’entrée. Que je fusse subtil, c’est ce dont il m’importait de me convaincre. Romancier, mon ami, me disais-je, nous allons donc te voir à l’œuvre. Décrire! Ah, fi! ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais bien de découvrir la réalité sous l’aspect… En ce court laps de temps qu’il t’est permis de séjourner à la Quartfourche, si tu laisses passer un geste, un tic sans t’en pouvoir donner bientôt l’explication psychologique, historique et complète, c’est que tu ne sais pas ton métier.
Alors je reportais mes yeux sur Monsieur Floche; il s’offrait à moi de profil; je voyais un grand nez mou, inexpressif, des sourcils buissonnants, un menton ras sans cesse en mouvement comme pour mâcher une chique… et je pensais que rien ne rend plus impénétrable un visage que le masque de la bonté.
La cloche du second déjeuner me surprit au milieu de ces réflexions.